Rechercher : henri Michaux
Marché de la Poésie : Isabelle Lévesque
Vous présenter sans plus tarder la poète Isabelle Lévesque, qui sera présente sur le stand de Diérèse et des Deux-Siciles, au Marché de la poésie :
Isabelle Lévesque fait partie du comité de rédaction de la revue Diérèse dont elle a co-dirigé les numéros spéciaux Thierry Metz et Nicolas Dieterlé.
Elle a publié en 2011 Or et le jour (Anthologie Triages, Tarabuste), Ultime Amer (Rafael de Surtis), Terre ! (éd. de l’Atlantique), Trop l’hiver (Encres vives). En 2012 : Ossature du silence (Préface de Pierre Dhainaut – Les Deux-Siciles). En 2013 : Un peu de ciel ou de matin (Dessins de Jean-Gilles Badaire – Postface de Pierre Dhainaut, éd. Les Deux-Siciles) et Va-tout (éd. des Vanneaux). En 2014 : Ravin des Nuits que tout bouscule (Préface de Pierre Dhainaut – Ecrits du Nord – Editions Henry, Prix des Trouvères).
En italien (livre d’artiste) : Neve, photographies de Raffaele Bonuomo, traduction de Marco Rota (Edizioni Quaderni di Orfeo, 2013). Voir la note sur ce blog, en date du 30/4.
Elle publie également des articles sur des sites internet (Terres de Femmes, Poézibao, La Pierre et Le Sel). En une seule ligne, reportez-vous à ce lien :
http://terresdefemmes.blogs.com/mon_weblog/2014/06/pierre-
dhainaut-progr%C3%A9claircie-suivi-de-largesses-de-lair-
par-isabelle-1%C3%A9vesque.html
La couverture du livre qu'elle signera le 14 juin à partir de 16 heures, stand 214 :
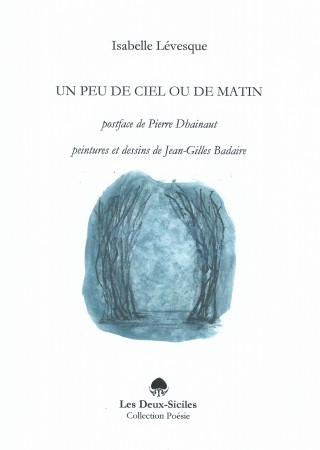

* *
Un peu de ciel ou de matin, d’Isabelle Lévesque, éditions Les Deux-Siciles
Pour être, la poésie n’attend que notre regard.
Andrée Chedid
Quelque chose s’est passé.
Déjà sous forme de traces dans Va-Tout, le précédent livre d’Isabelle Lévesque, on distinguait, au-delà de l’emportement d’un verbe jamais en repos et dans les espaces souvent torturés de la dislocation, des moments appelant la réconciliation et une espèce de douceur, certes poignante, mais annonciatrice.
L’introduction du « Tu », du « Toi » établit une tout autre dimension de l’écriture, une introduction du murmure – ce qui à l’oreille est murmuré – une proximité avec ce troisième personnage de l’accord, amant peut-être, partenaire, troisième terme de la parole. De l’écriture brusquée du précédent livre, on entre ici dans une douceur du phrasé, dans lequel on aenvie de fermer les yeux, « nocturne paupière arrimée ». La présence de ce tiers est un gage d’inspiration et essentiellement de partage. Douceur retrouvée dans la légèreté extrême : « D’une libellule » où « tu fais couleur », « lune ou reflet », et bien différente de la sécheresse, actuelle, du commentateur qui constaterait la métamorphose d’un œil distant. Il faut laisser au lecteur le temps et l’espace de se couler dans la joie du souffle, à mots couverts, où tout devient (redevient) couleurs. « J’attends que tu lèves des opérations silencieuses », comme si, à l’évidence, « Tu » était chargé de l’autre partie du sens, comme ami penché sur ce qui là se travaille. Ici, une musique nouvelle réunit et rassemble, le heurt des phrases entrecoupées ou blessées semble se résoudre dans une « paix du soir ».
Lieu où les voix viennent s’emmêler dont celle, permanente, d’un « chant éternel », comme lorsqu’on devient l’autre, non plus seulement cela qui nous habite mais qui aide à porter « le phare venu de loin ». « …danses lumineuses », « porte ultime », « seuil parfumé des sons », on ne peut mieux décrire ce qui est une des origines de l’écriture actuelle d’Isabelle Lévesque, hymne à un poétique bonheur retrouvé, dans la tradition française des chants d’amour. Une exaltation en sourdine, loin des grincements de Va-Tout. Cependant, il ne s’agit pas seulement de littérature mais de vers qui ont pris corps : « je glisserai entre tes mains forme nouvelle / et prendrai corps si près des vers / que nous dirons d’une même voix / une même prière », d’une dimension érotisée de l’écriture où « les mots de l’encre / font au papier un vœu de foi », lorsqu’un « sésame laisse passer nos caresses /et [que] les courbes font chemin ». Comme si encore l’encre et l’être aimé étaient des substituts de l’écriture – ce qui ici est aimé et traversé– captée dans des invocations : « Tu es mon encre … », « Tu es entre deux pages », « Tu es la sève… », « Tu es l’inespéré… », cet autre « Tu » du corps ou le « Tu » de l’écriture.
Celui ou celle qui vient éveiller les sens en jachères, qui reconnaît les « valeurs », « …les herbes fines / des coquelicots couvrant / parce qu’ils sont vifs, / les promesses oranges ». Et quelque chose de nouveau brûle qui invite à la danse quand « le feu se penche / riant lumière ». Une présence désormais qui soufflerait sur les braises des mots et des sons associés « pour qu’un seul vers, peut-être, / rende à mes nuits le souffle ? ». Couleurs extrêmement vibrantes, souvent unies à la flamme – le coquelicot en est un des représentants – mais toujours dans cette tonalité du murmure, « à pas couverts des mots … », dans « … l’onde légère de nos terres ardentes » , une délicatesse, à l’instar des toiles et des signes de Chine. Ce qui implique nécessairement des choix linguistiques : « Nous oublions pronoms, / même les verbes, terminaison volée . / Seuls les gestes déclinent / et je maudis petits mots dits, / articles / et les signes qu’il faut trouver / pour échapper / à la nuit. », révoquant une certaine lourdeur d’une langue articulée et subordonnée, pour laisser comme de l’espace à d’autres articulations plus enfouies, espaces relayés par les dénominations de silence, mystères, crépuscule, ombres… ; ce qui implique aussi que dans les signes enchevêtrés, il faille dénouer les trames de ce qui s’est tissé, fonction probable de ce « tu » toujours mystérieux, aux frontières du texte, parfois caché en son centre et qui tente de « conjuguer » les trois termes de l’écriture : « aimer respirer écrire », à l’image du poème, du poète et de l’autre.
Isabelle Lévesque invite ainsi à une réflexion sur la poésie, comme pluralité des différents acteurs de l’écriture, c’est-à-dire aussi comme partage d’une expérience de la complexité, ce qui implique le tissage et le dénouage. C’est dans cette respiration légère que quelque chose « a trouvé sa flamme », morceau de ciel ou de matin, avec la conscience constante et douloureuse de l’impermanence même du poème : « Souffle humide et léger / de ce qui reste, / l’haleine du ciel et le dernier regard / avant / ce qui s’éteint. ».


