30/04/2014
En hommage à Marcel Béalu
A propos de Marcel Béalu (né en 1908 à Selles-sur-Cher ; mort en 1993 à Paris), ce témoignage de Christiane Parrat, que je vous laisse découvrir :
"C'était à la librairie Le Pont traversé au Quartier Latin, dans les années soixante : mon île de calme et de volupté. Rien que des livres que je pouvais lire jusqu'à plus soif sous le regard bienveillant de Marcel Béalu. Comme ma bourse était plate, cela me convenait bien. C'était l'époque de Noces de Sang de Lorca au théâtre du Vieux Colombier (en 1963). Jenny assurait la mise en scène et j'entends encore la voix de Germaine Montero dans le rôle de la Madre. Ce fut le premier livre que je cherchais sur les rayons poussiéreux de l'antre de Marcel Béalu. Il m'ouvrit à ce grand poète. Puis vint la parole claire de René Char in Lettera Amorosa. Une Parole en... archipel qui en appela bien d'autres.
Ponge, Tardieu et Michaux suivirent de près et j'entrais en poésie comme on ouvre une porte interdite. Vision déréglée, subversive et tellement "vraie" du monde. J'étais alors, au Pont traversé, juchée sur un tabouret, adossée aux étagères, tellement absente à ce qui n'était pas le livre où j'étais plongée que les heures passaient comme un songe, me laissant porter par les mots. Quelques lecteurs assidus s’y retrouvaient de même. Nous nous passions des livres, des titres, des fragments de textes.
La rencontre avec le théâtre de Beckett, je la lui dois aussi. Malone, Pozzo et Lucky devinrent mes amis imaginaires et dérisoires dans ce monde un peu absurde. Je demandais à M. Béalu où trouver des livres de Colette - ma grande passion à l'époque. Il me mit dans les mains Le fanal bleu édité par Ferenczi. J'ai encore ce merveilleux livre imprimé en 1949 (pour lequel il me fit un prix d'ami ! Sur la page 42 un effacement des signes typographiques formait une bande verticale et j’essayais de rétablir le texte manquant du mieux possible, au fil des années). Un jour, je découvris Le mariage de Don Quichotte, de Paul-Jean Toulet : une édition de 1924, du Divan. J'étais bouleversée par le grand gémissement de la sirène qui s'enfonce dans la mer quand le Quichotte s'écrie : "Je te connais, tu t'appelles hallucination !". Bien d'autres livres encore, lus sur place, appelant plus tard d'autres lectures. Bachelard, L'eau et les rêves, édité par Corti, c'est là aussi que je l'ai découvert.
Un jour, il y eut Le chant du monde de Jean Giono. Encore une vieille édition de 1934 ! Livre qui me conduisit à un autre : Que ma joie demeure... 1965... moult hésitations. Que faire de ma vie que je voulais bohème, en marge ? Et ce fut la rencontre à Manosque avec Jean Giono, si doux et patient, qui m'ouvrit un chemin. Un trou dans le temps pour me poser, confiante, face aux années à venir...
Les années soixante ? Deux guides : Marcel Béalu et Jean Giono.
Voilà, quelques fragments de mémoire comme des laines de troupeau laissées sur les griffes des arbres et des clôtures, lors de mes transhumances."
Christiane Parrat
A lire aussi, la contribution de Jean Gédéon: "Marcel Béalu, un poète de l'Ecole de Rochefort" (12/12/2011) : http://pierreetsel.typepad.fr/la-pierre-et-le-sel/
07:15 Publié dans Auteurs | Lien permanent | Commentaires (0)
29/04/2014
"Mémoires de l'ombre", de Marcel Béalu
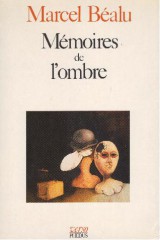 En décembre 1986, les éditions Phébus eurent l'heureuse idée de réunir en un seul tome les "Mémoires de l'ombre" de Marcel Béalu, composé de 120 récits brefs. Ouvrage singulier à bien des égards (la première édition desdites Mémoires (Debresse, 1941) réunissait 22 récits seulement ). Celle-ci, enfin complète, parue sans l'aide du CNL, mais qu'à cela ne tienne.
En décembre 1986, les éditions Phébus eurent l'heureuse idée de réunir en un seul tome les "Mémoires de l'ombre" de Marcel Béalu, composé de 120 récits brefs. Ouvrage singulier à bien des égards (la première édition desdites Mémoires (Debresse, 1941) réunissait 22 récits seulement ). Celle-ci, enfin complète, parue sans l'aide du CNL, mais qu'à cela ne tienne.
Jean Paulhan avait remarqué cet auteur, né en 1908 à Selles-sur-Cher en Sologne, fervent autodidacte, préservé de toute formation universitaire. Qui, chapelier à ses heures, devint libraire au Pont Traversé, d'abord rue de Beaune (à Paris), puis rue Saint-Séverin, enfin rue de Vaugirard, à l'angle de la rue Madame. Dans les années 80, j'habitais à quelques pas une chambre de bonne rue d'Assas et Marcel B., à qui je venais rendre visite dans sa petite librairie au fil de mes déambulations, a pu me parler entre autres de ses rapports tendus avec les éditions de la Fée Morgane, où il avait pourtant publié Erreros. Ou de la confidence de Raymond Bellour sur les troubles confessés d'un Henri Michaux, voyant au réveil s'enfuir sous son lit quelques rats, fantasmés bien entendu, ceci dit pour rappeler qu'il avait, passée l'anecdote, en grande estime l'auteur de La Nuit remue.
Dans son "Théâtre souterrain" (p. 137 à 189), le narrateur, telle la Méduse se voit doté de "Cinq têtes", munies d'yeux qui voient dans tous les sens, la dernière pour le coup "ne pouvant regarder que le ciel" ; un orthopédiste finit par ne lui en redonner qu'une seule. Sauvé !... Course aveugle ou presque, entre des images qui s'imposent dans leur "évidence" et un "vertige de possession qui s'av(ère) impossible", devant toutes les cibles que lui propose le dehors proliférant. Tout est dans le ton adopté, la plasticité de l'être, et jamais de plaintes affichées, au contraire, une fascination pour ce qui chute ou est sur le point de s'écrouler. Certains récits (poétiques, dans le fond) ne sont pas sans rappeler les fantasmes baroques d'André Pieyre de Mandiargues.
Comment croire en soi quand le doute s'instaure et vient saper toute certitude (relisons sans tarder les fables oniriques de Pierre Bettencourt), fort de cette "revanche" prise contre un univers hostile dans ses grandes lignes, où le narrateur se découvre "immobile et l'âme délirante d'une ivresse sans nom" ?
Face à la multiplicité des personnages qu'il anime, d'aventure en aventure, le narrateur n'aspire pas à crever la toile, mais simplement à se couler le mieux possible dans un moule capricieux. Du "Puisque tu rêves, rien n'a d'importance..." à "Tu ne rêves pas !" ("Les deux voix"), ainsi se lit, dans un bric-à-brac non chronologique où règne l'arbitraire pur, l'approche d'un infini aléatoire : de l'illusion à l'illusion de l'illusion, paraissent tour à tour ou bien étroitement imbriqués deux mondes (l'ordinaire et le surréel), qui se révèlent vases communiquants. Là où précisément tente de s'immiscer l'écriture, pour tirer son épingle du je(u), dans un affrontement à la monstruosité du Désir, multiforme, incontrôlé, incontrôlable.
Tout est contenu dans l'instant, rien ne se laisse deviner dont nous ne portons la trame en nous, selon un ordre qui nous dépasse mais que l'esprit réinterprète à mesure comme s'il en avait la maîtrise. En double-aveugle et sous la loupe de rosée d'un imaginaire des plus excitants, tout morcelé qu'il se révèle et s'écrit.
Daniel Martinez
07:39 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (1)
27/04/2014
"Traité des excitants modernes", d'Honoré de Balzac
En avril 2003, les éditions Arléa - qui ont vu le jour en lieu et place de la librairie "Les Fruits du Congo" - proposaient à la lecture un curieux texte de Balzac, extrait de la Pathologie de la vie sociale. Curieux car moralisateur, là l'occasion pour l'auteur du Lys dans la Vallée de pointer du doigt cinq substances : l'eau-de-vie ou l'alcool, le sucre, le thé, le café (concassé à la turque ou moulu ; on se le rappelle, notre Tourangeau, la cafetière de porcelaine toujours à portée...), le tabac. "Fumer un cigare, c'est fumer du feu" : si Balzac doit à George Sand de l'avoir initié à ce plaisir, qui va du houka de l'Inde au narguilé de Perse, il ne tarit pas d'éloges envers disons ces "dérivatifs", précisément : "Votre cerveau acquiert des facultés nouvelles, vous ne sentez plus la calotte osseuse et pesante de votre crâne, vous volez à pleines ailes dans le monde de la fantaisie, vous attrapez vos papillonnants délires, comme un enfant armé d'une gaze qui courrait dans une prairie divine après des libellules, et vous les voyez sous leur forme idéale, ce qui vous dispose à la réalisation."
La réalisation : c'est bien le but - ici avoué - du romancier, dont nul n'ignore les excès en tous genres. Ou se réaliser, si tant est que l'auteur authentique relègue au second plan les menus soucis, heurs et malheurs de la vie quotidienne, quitte à brûler la chandelle par les deux bouts. Relisant les Pensées de Joseph Joubert, je note, tout à trac : "Le vin n'ôte pas sa conscience à l'homme. Au contraire, il la lui rend souvent plus vive (et l'exagère). Il ramène un certain cours de la mémoire où est la notion du juste. L'ivre de vin sent Dieu. Les ivres d'esprit sont seuls impies." Chez Balzac, rien d'approchant, cette distinction n'existe pas, il est dans son plaisir, à part entière. Au concert, à Paris, alors que son "âme était grise" et qu'il "sommeillai(t) à demi", il entend :
«"Ce Monsieur sent le vin", dit à voix basse une dame dont le chapeau effleurait souvent ma joue, et que, à mon insu, ma joue allait effleurer. J'avoue que je fus piqué. "Non, Madame, répondis-je, je sens la musique."» Plus loin : "J'ai dès lors très bien conçu le plaisir de l'ivresse. L'ivresse jette un voile sur la vie réelle, elle éteint la connaissance des peines et des chagrins, elle permet de déposer le fardeau de la pensée." Pour conclure, souverain : "L'ivresse est un empoisonnement momentané". Dont acte.
Raisonnablement, croira-t-on Balzac convaincu par ce qu'il écrit là, vantant d'un côté les mérites des excitants, pour les réduire ensuite à la peau de chagrin de la Raison ? La belle affaire ! Ce livre est en fait bien drôle car les préceptes énoncés ne seraient susceptibles que de s'appliquer "à qui de droit", précisément pour ceux qui ont charge d'âmes, dans l'échelle sociale ; enfin, pour éviter "les maladies, et, en définitive, l'abréviation de la vie." Comme chacun sait, l'auteur de La Comédie humaine, enfant sans mère, est mort à 51 ans, asphyxié lors d'une de ses crises d'étouffement.
Laissons-le conclure (?) ou à peu près : "Appelez la vie au cerveau par des travaux intellectuels constants, la force s'y déploie, elle en élargit les délicates membranes, elle en enrichit la pulpe ; mais elle aura si bien déserté l'entresol, que l'homme de génie y rencontrera la maladie décemment nommée frigidité par la médecine. Au rebours, passez-vous votre vie au pied des divans sur lesquels il y a des femmes infiniment charmantes, êtes-vous intrépidement amoureux, vous devenez un vrai cordelier sans froc." En définitive, le corps humain est pour Balzac avant tout une machine, et point de "carburant" à l'excès, au risque de ne plus exister que par défaut ; ce qui, à la réflexion, reflète quelque peu la vie même de l'écrivain, peu ou prou éclipsée par l'acte d'éciture, qui relègue sa personne au second plan.
Daniel Martinez
10:12 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0)

