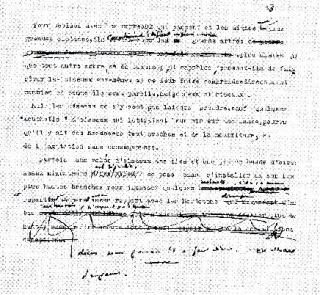Rechercher : henri Michaux
”Idéogrammes en Chine”, de Henri Michaux, éditions Fata Morgana, 14 juin 1975, 46 pages
Toute langue est un univers parallèle. Aucune avec plus de beauté que la chinoise.
La calligraphie l'exalte. Elle parfait la poésie ; elle est l'expression qui rend le poème valable, qui avalise le poète.
Juste balance des contradictoires, l'art du calligraphe, marche et et démarche, c'est se montrer au monde. - Tel un acteur chinois entrant en scène, qui dit son nom, son lieu d'origine, ce qui lui est arrivé et ce qu'il vient de faire - c'est s'enrober de raisons d'être, fournir sa justification. La calligraphie : rendre patent par la façon dont on traite les signes, qu'on est digne de son savoir, qu'on est vraiment un lettré. Par là, on sera... ou on ne sera pas justifié.
La calligraphie, son rôle médiateur, et de communion, et de suspens.
Une langue, en Occident, qui aurait eu seulement une parcelle des possibilités calligraphiques de la langue chinoise, qu'en serait-il advenu ? Les époques baroques qui s'en seraient suivies, et les trouvailles des individualistes, les raretés et bizarreries, excentricités et originalités de toute sorte...
La langue chinoise en était capable. Partout elle donne des occasions à l'originalité. Chaque caractère fournit une tentation.
Henri Michaux
25/06/2020 | Lien permanent
”Henri Michaux : Les années de synthèse 1965-1984” éditions Galerie Thessa Herold
"Étrange émotion quand on retrouve le monde par une autre fenêtre - comme un enfant, il faut apprendre à marcher - on ne sait rien." Ces lignes, Michaux les écrit en 1931, quand, poète devenant peintre, il "changeait de gare de triage". Aujourd'hui, on regarde et on lit Michaux. On pense le connaître, mais "on ne sait rien". On approche des œuvres muni de ce seul rappel ancien : "Dans le noir nous verrons clair, mes frères" (1933).
La nuit remue. On entre dans le monde de Michaux, dans son mouvement : foules en marche, précipitations et ralentis, visages en mue, arborescences, monstres, multiplications, torsions, rythmes grouillements, tracés mouvants du dessin post-mescalinien... Le remuement de Michaux devient le nôtre. Il nous conduit à d'autres terres, au trouble, au péril, à la clairvoyance.
Le catalogue de l'exposition met en correspondance des œuvres et des textes. Ils n'appartiennent pas au même temps. Cette suite composée va du noir au noir. La première œuvre, de 1981, dialogue avec un texte de 1938 :
Pour le moment
je peins sur des fonds noirs
hermétiquement noirs.
Le noir est ma boule de cristal.
du noir seul je vois de la vie sortir.
A la dernière page, une peinture datée 1982-1984, bâtie comme une des peintures noires de Goya, fait écho à cet écrit de 1964-1966 :
La naissance de la Grande Mort
de la Mort universelle
a commencé
(...)
Tu vas continuer sans nous, Terre des hommes
Tu vas continuer, toi.
Peut-on parler de ces années (1965-1984 : soit l'année où le peintre a acquis sa réputation et celle où il nous a quittés) comme d'"années de synthèse" ? Au catalogue, Rainer Mason (qui accompagne de ses écrits les œuvres du plasticien) lui-même en doute : "les travaux de Michaux sont d'une remarquable cohérence, comme la musique, ils produisent de l'inouï par les répétitions et les variations".
Le temps, qui asservit le lecteur de l'écrit, est volatilisé par la peinture : "pas de trajets, et les pauses ne sont pas indiquées, écrit le poète-peintre. Dès qu'on le désire, le tableau à nouveau, entier. Dans un instant, tout est là. Tout, mais rien n'est connu encore. C'est ici qu'il faut commencer à LIRE".
Lire Narration et Alphabet (1927). Lire tache, "Un poulpe ou une ville" (1926). Ou encore, un mot-monstre, un mot, et ses figures, Meidosem. "Plus de bras que la pieuvre, tout couturé de jambes et de mains jusque dans le cou, le Meidosem." Un mot à lire dans tous les sens, sans retenue, un mot qui excède ses figures graphiques, "tendu vers un monde où la suée même est sonore". Pour ma part, dans ce sème, dans ce meidosem, j'ai toujours entendu, surgi de la Théogonie et de la Tragédie, étymologique, un rire (le meido grec), en dépit des mots de la narration : "Oh ! elle ne joue pas pour rire. Elle joue pour tenir, pour soutenir". Le soutien d'un rire meidosem.
Les mots sont des "partenaires collants", et collante aussi l'huile de la peinture. Défiant, Michaux ruse avec ce médium. Il revint "voûté d'un grand silence" de sa première vue de Klee, à partir duquel il écrivit Les aventures d'une ligne. Tout se joue dans cette distance entre ce qui véhicule la pensée et son accomplissement. Dans ce retour au pré-langage qui mêle l'instinctif au culturel et le conditionne, à la réflexion. Dans une réalité dès lors recomposée, qui n'étouffe pas les moi initiaux, en quête d'identité.
Georges Raillard
10/02/2021 | Lien permanent
”Le jardin exalté”, Henri Michaux, éditions Fata Morgana, 32 p., 14/6/1983, 1800 exemplaires
Voix sans pareille : Henri Michaux parle de lieux et de moments que l'on ne saurait situer, sinon dans la gorge, le regard, le cerveau qui sont les siens, les nôtres. Cela surgit d'entre les pages sans qu'il faille mettre un nom au frontispice du volume : voix aussitôt reconnue. L'aventure d'aujourd'hui concerne un coin de réel qui oscille entre le vu et l'inventé : tel est le Jardin exalté.
Les opérations de cette prose ne sont réductibles à aucun art poétique qui serait le partage du siècle. Elles se produisent sur fond anonyme de silence et d'ensorcellement. Un départ abrupt et anodin : "Il restait un peu du produit préparé, lorsque quelques jours plus tard on me proposa un jardin à la campagne. Quelqu'un voulait faire un essai." C'est le commencement d'une périlleuse expérience hors des limites de soi, maintes fois tentée, encore une fois réitérée. Vie et livre hors des normes et des bornes.
Le texte est fait d'une suite de paragraphes que séparent les ellipses des sensations et des pensées communes. Le reste du monde est abîmé dans ces trouées blanches de la typographie. Une attention sèche, anxieuse et comme mêlée à l'état second du drogué est accordée à quelques moments cernés de mutisme.
Le narrateur et sa compagne ont bu. Quels en sont les effets ? La métamorphose est permanente. L'organisme et l'univers deviennent des vases communicants. Le passage du produit dans le corps entraîne un monde autre. En gros plan, les impressions se déchiffrent sur la face de la partenaire, qui révèle à son corps défendant de multiples identités. Et soi-même (le narrateur, le lecteur), on se laisse assiéger par les mutations aiguës qui affectent les sens et les alentours : "Comme l'eau avance dans le lit d'un fleuve, pareillement la musique avançait dans le lit de mon être, entretenant, entraînant ampleur, et aspiration à l'ampleur." Malaise, vertige, euphorie.
Porté par cette prose, voilà qu'on sort de soi, rendu à la présence bruissante du jardin, "l'inespéré paradis" sans oripeau religieux ni symbole métaphysique. On déborde maintenant d'une félicité universelle qui n'est peut-être que l'intime conviction du sentiment d'exister un parmi tous. La matière a une âme, l'homme s'immerge dans cette âme matérielle qui lui offre enfin "le supplément attendu depuis longtemps".
On demeure confondu, au seuil du domaine, sous l'arbre de la connaissance, "là où l'indicible reste secret, sacré ". Là où la personne rejoint l'univers. Mutuelle étreinte, réciproque paraphrase.
Serge Koster
22/02/2021 | Lien permanent
La communion de l'homme et de la nature, dans ”Le Jardin exalté”, d'Henri Michaux
... Car ces débordements passionnés avaient lieu au sommet d'un arbre (et je ne m'en étonnais pas), sur un vieux noyer, à la couronne large, si rare en cette essence, couronne double presque triple, quasi sans exemple, troupe dont chaque membre, infatigablement excessif, se précipitait en avant, se retirait, se reprécipitait sans repos.
Exaspération sans personne, où toutes les parties, branches, feuilles et rameaux étaient des personnes et plus que des personnes, plus profondément remuées, plus bouleversées, bouleversantes.
Individuellement, non communautairement, dans un rythme accéléré, où le vent réel ne paraissait pas pourtant le principal.
Feuillage s'inclinant bas, rapidement, puis fougueusement remontant, puis ramené en arrière, puis repartant inlassable, pour l'inlassable dépassement, froissé, défroissé presque sauvagement, cependant en vertu d'une sorte de consécration, avec une grandeur unique.
Beauté des palpitations au jardin des transformations.
Assouvissements et inassouvissements partaient de l'arbre aux ravissements.
Appels aux assoiffés, appels enfin entendus, exaucés. Le supplément attendu depuis toujours était reçu, était livré.
L'infini chiffonnage - déchiffonnage trouvait sa rencontre.
Et s'ouvrait, se refermait le désir infini, pulsation qui ne faiblissait pas.
Entre Terre et Cieux - félicité dépassée - une sauvagerie inconnue renvoyait à une délectation par-dessus toute délectation, à la transgression au plus haut comme au plus intérieur, là où l'indicible reste secret, sacré...
Henri Michaux
* * *
Ndlr : c'est ici le dernier texte de Michaux sur la drogue, après la parution de "Par surprise" le 24 mai 1983. Il m'a paru intéressant de donner en raccourci le parcours du poète jusqu'à son terme (Henri Michaux vient alors d'avoir 84 ans) sur les voies d'une énergie intérieure libérée, au fil de la moindre impulsion jusqu'à la plus vive, la moins prévisible, partant la plus délectable : "Là où la personne rejoint l'univers". Il n'y a pas chez le poète simple désir de s'extraire de son carcan existentiel pour jouir en spectateur de ce qui s'offre à lui mais bien celui d'accéder à l'essence des sensations dans leur surgissement et de les reconnaître pour telles sur le chemin de leur apparition, aussi fugitives en soient les ondes quand elles traversent l'être, le renouvelant de l'intérieur.
Le 8 août 1983, Michaux reçoit ces mots de Joyce Mansour à propos de son petit livre : "J'ai eu très peur en vous lisant. Vous êtes allé si loin sur le chemin du Soufi, n'est-ce pas ? J'ai eu vraiment peur en pensant par où et comment vous êtes passé. J'ai eu vraiment peur. Vous effleurez des choses si secrètes comme ça, du bout du pinceau. Heureusement vous êtes là au bout du fil des jours qui relie tant bien que mal l'oreille à la ville.
Je vous envie ce voyage-là. J'ai peut-être entrevu l'arbre immobile dans la tourmente, l'arbre furieux dans le silence, loin derrière les gigots et la palissade de la santé quotidienne. Assez pour reconnaître le danger de l'entreprise, la beauté du paysage et la sérénité du voyageur." in La Pléiade, tome III, pages 1825-1826.
24/02/2021 | Lien permanent
12 février 2008 : La vente de la bibliothèque de Gwenn-Aël Bolloré, avec Henri Michaux en vedette !
Ce fut le rare moment de brouhaha dans une salle pleine et attentive, plus de trois heures et demie durant, chez Sotheby's, mardi 12 février 2008, de la bibliothèque de Gwenn-Aël Bolloré, pour un montant total de 1,43 million d'euros : l'enchère de 120 000 € (plus les frais) atteinte par les quinze pages d'écriture tracées par Henri Michaux sous l'empire de la mescaline pour être insérées dans Misérable miracle - record absolu pour une œuvre, graphique ou littéraire, de l'auteur de Connaissance par les gouffres. La photographie de Michaux prise par le papetier breton sur le perron de la demeure familiale, près de Quimper, qui lui avait valu les reproches du Barbare en Asie ("Vous m'avez volé mon âme"), n'a obtenu que 1 600 € (estimée à 2000-2500 €).
En revanche, les prix de la plupart des œuvres de Michaux, soit plus de 50 numéros sur une vente qui en comptait 243, se sont envolés : 32 000 € pour les dessins destinés à illustrer Entre centre et absence, 26 500 € pour une édition accompagnée d'un pastel des Meidosems, tandis que Nous deux encore, un texte écrit par le poète après la mort tragique de sa femme et qu'il ne voulut jamais rééditer, obtenait 6 500 €, très au-delà de ce qui était annoncé.
Le début de la soirée avait vu les Chants de Maldoror, illustrés par Salvador Dali, adjugés 340 000 €, tandis que l'intrigant carnet noir contenant des poèmes de jeunesse d'André Breton et ayant appartenu à Eluard, partait à 25 000 €, en dessous de l'estimation basse. Souvent, le dire des experts a été contrarié : vers le haut pour un des six cents premiers exemplaires d'Histoire d'O (de Pauline Réage, alias Dominique Aury) sous une reliure rose et or, qui enflamma les amateurs à 17 000 € (plus de 10 fois l'estimation haute) ; vers le bas, pour le dernier manuscrit de Céline encore en circulation, celui de Nord (1959), mis sous cuir avec une inscription en forme d'exorcisme par le collectionneur-résistant qu'était Bolloré, et qui fut adjugé, au téléphone, à 360 000 € (au lieu des 400 000 à 600 000 annoncés). Si des bibliothèques municipales bretonnes (Saint-Brieuc ou Quimper) ont préempté des ouvrages de Louis Guilloux ou de Max Jacob, aucun représentant de l'Etat n'a fait de même.
La dispersion d'une bibliothèque n'est pas une vente comme une autre. On y feuillette une dernière fois les pièces réunies au long d'une vie de courage (l'engagement à 17 ans du jeune Gwenn-Aël qui rejoint l'Angleterre sur un voilier et revient dans le premier groupe de Français qui débarquent le 6 juin 1944) et de passion. Celle qui mène le papetier à prendre la tête, dans les années 1950, des éditions de la Table ronde, qui publieront notamment Boris Vian (L'Arrache-Coeur, 1953, parti à 6 200 €), puis les "hussards", Blondin, Nimier, Laurent et Déon.
Ce sera la partie moderne de la vente, annoncée par des œuvres de Bernard Franck, auteur de la formule "hussards" dans un article des Temps modernes paru en 1952. Son manuscrit intitulé Israël, d'une écriture ronde et serrée, sera emporté pour 19 000 € (estimation haute à 1 200 €), et l'édition reliée des Rats (1953) atteindra 1 100 € (estimée 300-600 €). Un important lot de manuscrits et tapuscrits de Roger Nimier (1925-1962), était très attendu. Si ce bel ensemble n'a pas suscité des records d'enchères (14 000 € au téléphone pour Amour et Néant, estimés entre 18 000 et 24 000), la présence palpable du travail d'un écrivain et de l'amitié qui le liait à son éditeur était renforcée par la silhouette discrète au fond de la salle de son héritière spirituelle, l'écrivain Marie Nimier.
Michèle Champenois
16/05/2021 | Lien permanent
Une vie mouvementée : Gaston Ferdière, et la rencontre de Henri Michaux opus 1
Gaston Ferdière est né le 16 février 1907 à Saint-Etienne. C'est un ami de jeunesse, Robert Maurice, auteur de plusieurs plaquettes, qui lui donne à découvrir "Keats et Shelley, mais surtout Mallarmé et les poètes des Marges."* Sa mère, née Cécile Riche, était caissière à l'un des trois "cafés Riche", achetés à Saint-Etienne, par ses parents ; elle meurt en 1926 d'une tumeur cérébrale. Gaston Ferdière fait à Lyon, après le baccalauréat, ses études de médecine. En 1931, il effectue sa cinquième et dernière année de médecine et obtient le diplôme "de médecine légale et de psychiatrie".
Avec sa femme Marie-Louise Termet, il s'installe alors en Val de Marne, affecté pour son premier poste à l'asile de Villejuif, il y passe ses deux premières années d'internat. Puis il intègre Sainte-Anne, pour y terminer son internat, en 1936. A Sainte-Anne (Paris), Ferdière invite André Breton (lui-même médecin psychiatre) et Marcel Duchamp à déjeuner ; et peu à peu le cercle s'élargit, des liens se tissent avec le couple Tanguy, qui résidait rue du Chemin Vert ; puis avec Claude Cahun et Suzanne Malherbe, qui organisaient chez elles des expositions surréalistes. "Un jour, Suzanne Malherbe et Claude Cahun nous invitent à dîner, Marie-Louise et moi, en nous disant que cette fois elles allaient nous présenter à un grand poète... C'était Henri Michaux... Il était assez clair qu'il gagnait mal sa vie et vivait en solitaire, d'ailleurs sans désirer étendre ses relations... Nous allions, Marie-Louise et moi, le revoir souvent." Avant que le couple ne divorce, en 1942.
Il passe sa thèse de médecine (L'érotomanie. Illusion délirante d'être aimé), mais son anti-conformisme lui barre toute carrière universitaire. D'abord nommé dans le Cher ; puis, sur ordre de Vichy et à cause de son engagement politique, il est affecté en 1941 à l'hôpital psychiatrique de Rodez, qu'il quittera en 1948, pour un exercice privé, d'abord dans le pays basque, puis à Paris à partir de 1961 jusqu'en 1976.
Gaston Ferdière publiera six plaquettes de poésie, dont Ma mère Jézabel ("En marge", 1938) qu'il offrira à Hans Bellmer (qui a été l'un de ses patients, avec Unica Zürn) ; dans sa lettre du 24 fév. 1948, Bellmer le remercie pour ce recueil : "la lecture, dans le train même [pour Toulouse] de votre poème 'Ma mère Jézabel' et de votre étude m'a redonné l'équilibre, l'idée de non-solitude." A noter que son style n'avait rien de surréalisant. Ses premiers poèmes montrent plutôt l'influence de Francis Jammes, voire du Moréas des Quatrains... Pour les curieux, voici les cinq autre titres des recueils édités : L'Herbier, 1926, La chanson fruste, 1927, Ma Sébile, 1931, Paix sur la terre, 1936, Le Grand matin, 1945.
Les travaux et les curiosités de Ferdière – sur le versant linguistique – ont porté non seulement sur la poésie, mais sur les jeux de langage enfantin et les mots-valises. C'est ce goût du ludique qui explique qu'il ait confié à Antonin Artaud le photomontage de la contine "Roudoudou n'a pas de femme", et la traduction du poème "Jabberwocky" de Lewis Caroll. Artaud a vu un sens sexuel dans la contine et détesté le poème, Antonin écrit alors : "Quand on creuse le caca de l'être et de son langage, il faut que le poème sente mauvais, et "Jabberwocky" est un poème que son auteur s'est bien gardé de maintenir dans l'être utérin de la souffrance où tout grand poète a trempé et où, s'accouchant, il sent mauvais." (à ce propos, on se reportera utilement à la thèse soutenue à Paris VII par B. Zrim-Delloye, "Artaud, les psychiatres et l'institution psychiatrique", 1985). Mais il s'est remis à l'écriture : ce qui mérite ici d'être précisé, même si cette forme d'art-thérapie a été contesté par Paule Thévenin ("Œuvres complètes", tome X, éd. Gallimard, 1979). C'est donc l'acte de naissance des Cahiers de Rodez, avec les péripéties éditoriales que l'on sait...
Daniel Martinez
* les citations sont extraites du livre de Gaston Ferdière "Les Mauvaises fréquentations", épuisé.
Le numéro 42 de Diérèse (toujours disponible, 12,50 € + port), p. 129 à 143, contient un intéressant dossier "Gaston Ferdière".
21/04/2016 | Lien permanent
La vente aux enchères de la collection Breton... En regard : Adrienne Monnier, Henri Michaux.
Chacun se souvient de cette vente, qui eu lieu à l'Hôtel Drouot, du 7 au 17 avril 2003, initiée par Aube Elléouët, la fille d'André Breton, des tergiversations politiques qui l'ont précédée et sur lesquelles je ne reviendrai pas (on en trouve encore trace sur le Net, comme d'un mauvais roman-feuilleton). Entre autres, cet amour des bois flottés qu'avait Breton, passion qu'il partageait avec Gaston Ferdière (qui leur consacra plusieurs études), avec Max Bucaille qui "aidait" les racines qu'il déterrait, ou d'un Jean Carteret, cet inspiré qui permit au psychiatre d'Unica Zurn de choisir quelques pièces dans son étonnante et minuscule chambre, pleine comme un œuf... Se rappeler ce qu'a écrit sur le sujet Yves Bonnefoy, alors professeur honoraire au Collège de France, aux premiers jours de février 2003 :
André Breton à l'encan : vulgaire
Vous me demandez comment je prends la nouvelle de la vente aux enchères de la collection d'André Breton. Avec tristesse, avec un mouvement de refus.
A priori, je ne suis pourtant nullement hostile à la dispersion de ce qui fut assemblé. Regrettable, condamnable, l'atteinte aux instruments de travail, par exemple les bibliothèques savantes. Triste, la vente des œuvres ou des objets, souvent peu nombreux, dont quelqu'un avait fait son bien avec tant d'affection et parfois si peu de moyens qu'ils en étaient devenus son être même, lequel se dissipe une seconde fois maintenant.
Mais les collections, surtout les grandes, n'ont pas souvent cette qualité. Elles peuvent ne signifier que le fait qu'à un certain moment, en un certain lieu des pièces rares furent ensemble, et je connais des collectionneurs auxquels suffiraient, et ils ont raison, les quelques exemplaires d'un livre qui rappellerait qu'il en fut ainsi. Ce document désignerait ce mystère : qu'un être fut ; et la vie reprendrait ses droits en disséminant les objets comme constamment elle fait avec des vies.
Mais cette vente d'André Breton ? Eh bien, d'abord, je relève la vulgarité de cette entreprise de style grand magasin qui s'abat sur quelqu'un qui resta si exactement aux antipodes des manipulations commerciales, celles qui font choses des œuvres. Mais je remarque aussi l'intention, réfléchie, délibérée, que laissent paraître ce projet et ses prospectus. Breton, avec passion - ce mot galvaudé lui convient - ne rassemblait pas des objets, il reconnaissait des présences, au besoin il les ranimait ou en suscitait, il leur restituait leur dignité, ensemble elles étaient devenues chez lui une communauté vivante dans le miroir courbe de laquelle se dessinait la société à laquelle Breton rêvait pour l'avenir, et qui méritait notre attention, et notre respect.
Cette collection - mais faut-il la nommer ainsi ? - était de ce fait la poésie, radicalement. Or, c'est du regard de la poésie que beaucoup dans l'heure nouvelle ne veulent plus. A voir ce dépliant (présentant au public cette vente, ndlr) qui reprend, de façon perverse, une parodie qu'André Breton avait faite - avec, pour une fois, indulgence - d'une certaine façon d'être journaliste, je me suis souvenu de ce que Jacqueline Lamba disait dans des occasions semblables: "Ils l'ont eu".
Une question, toutefois. Un des aspects nocifs de la vente du "42, rue Fontaine", c'est qu'elle rendra difficile à l’État ou à des fondations de préserver par leurs achats peu ou prou de cette unité qui jusqu'à présent avait été maintenue. Mais comment se fait-il que de ces côtés-là rien n'ait été fait ou n'ait pu aboutir, pour prévenir cette situation ? Et aussi pour aider les héritières d'André Breton, certainement victimes, à ne pas tomber dans le piège ?
Il est vrai que nombre des collections léguées ou acquises par des musées, des bibliothèques, s'éteignent, dans l'empoussièrement des salles où elles échouent, sous vitrine. Mais n'a-t-on pas su voir qu'il y avait dans l'apport de Breton une flamme qui aurait consumé, au moins pour certains visiteurs - mais ce sont ceux-là seuls qui comptent -, cette impression délétère ? Qui aurait signifié l'espoir, à l'encontre de tant qui en bafouent l'idée même ?
"Je cherche l'or du temps", avait dit Breton, signifiant par cet or la présence à soi et aux autres de la personne à venir, là-même où le temps mal compris paraît signifier le néant, l'inutilité de tout, et inciter à l'indifférence. C'est sous le signe de cette phrase que beaucoup de jeunes gens s'étaient spontanément retrouvés, à sa mort, pour la seule cérémonie qui ait sens encore, celle qui atteste, en dépit de tout, sans préparation, sans mots d'ordre, cette espérance.
Sachons au moins prendre mesure, aujourd'hui, de ce qui à peine se dissimule dans ces annonces de ventes, de catalogues sur papier ou sur CD-ROM, dans ces bulletins de souscription avec indication du montant de la remise, dans cette évocation de "lots" de dossiers et d'albums dont le nombre semble se perdre dans le mauvais infini : ce que veut le plus la spéculation commerciale, c'est éradiquer jusqu'au souvenir de tout ce qui est aimant et libre.
Prenons mesure. Et faisons ainsi de cette vente la preuve, par l'absurde, que Breton avait raison, en tout cas souvent.
Yves Bonnefoy
Breton (à gauche, second plan), interne
au Centre psychiatrique de St-Dizier,en 1916
"Je ne manquai pas de regarder les lignes de la main d'André Breton ; une chose m'y frappa plus que tout : c'est la bizarrerie de la ligne de tête, qui indiquait clairement une prédilection du sujet pour la folie ; j'avoue que cela me fit un peu peur." : Adrienne Monnier, qui mérite d'être présentée ici:
Michaux la rencontre, à son arrivée à Paris, ou peu après, en 1925, dans la librairie qu'elle a ouverte dix ans plus tôt rue de l'Odéon, elle n'a pas beaucoup plus de 30 ans mais elle est déjà une des figures les plus en vue du monde littéraire. Elle réunit aux "Amis des livres" de grands écrivains de l'époque, qui ne se voient que là. De l'autre côté de la rue, la librairie "Shakespeare and Co", fondée par Sylvia Beach, son aînée de presque dix ans et sa compagne, accueille les grands écrivains américains de la Lost Generation qui vivent à Paris et, bien entendu, des Anglais, dont James Joyce. Sylvia Beach est surtout connue pour avoir, avec Valéry Larbaud, traduit Ulysse, alors interdit en Grande-Bretagne. Michaux est resté attaché aux deux amies. La fin d'Adrienne est tragique : souffrant atrocement d'une maladie incurable, elle se tue en 1955. Sylvia Beach lui survit jusqu'en 1962. Daniel Martinez
20/02/2020 | Lien permanent
Henri Michaux : ”Donc c'est non”, éd. de Jean-Luc Outers, Gallimard, 208 pages, 2016
Comme je vous le laissais entendre dans la dernière note du blog, Michaux fut d'abord l'homme du "non" ; l'heureux paradoxe est qu'il ait pu paraître sans encombre dans La Pléiade, sous l'oeil averti de celle qui fut sa compagne, Micheline Phankim. Car l'époque que nous vivons privilégie l'assertivité, fût-elle servile...
Ce livre dont je ne vous touche que quelques mots aujourd'hui : "Donc c'est non" réunit en son sein un certain nombre de lettres où Henri Michaux, sur la défensive, en position du hérisson, envoie gentiment promener - jamais chez lui d'emportement vulgaire - ceux qui essaient de l'entraîner sur des chemins qu'il n'aurait pas librement choisis. C'est Jean-Luc Outers qui s'est chargé de compiler lesdites lettres. Ce qu'Henri Michaux écrit à propos des prix littéraires : "J'excuserais une assemblée anonyme qui, siégeant secrètement dans une cave obscure, m'adresserait (...) une somme importante en signe d'enthousiasme."
Attitude constante donc, il demeurera jusqu'au bout fidèle à ses principes, refusant la collection Poésie/Gallimard comme sa panthéonisation dans La Pléiade ! La première car il estimait qu'"un livre, cela se mérite" (et que le tenir en poche ne serait pas acceptable), la seconde car le rendu de ses nombreux livres illustrés en aurait pâti : "Laissez-moi mourir d'abord", répliquait-il. Toujours dans cette optique, il est resté jusqu'à sa mort, le 19 octobre 1984, fidèle à Fata Morgana, quitte à ce que les lithos de l'un de ses dernier livres, "Saisir", n'aient pas eu la qualité que l'on était légitimement en droit d'attendre pour pareille édition.
Je vous communiquerai plus tard l'une de ses lettres de refus (inédite), non reproduite dans cet excellent livre, "Donc c'est non", fidèle à la personnalité de ce poète hors normes que fut Henri Michaux. Daniel Martinez
23/04/2016 | Lien permanent
”Le malheur, mon grand laboureur...” : ”Meidosems”, d'Henri Michaux, éditions Le Point du jour, 31/10/1948, 95 pages, 29
Le 23 février 1948, Henri Michaux perd sa femme Marie-Louise, suite à un accident domestique (au cours d'une séance de repassage, sa robe de chambre en nylon qui prend feu la brûle vive ; elle en meurt un mois après) et il invente alors ce tout dernier peuple imaginaire dans son œuvre, les Meidosems, en manière d'exorcisme. Son recueil paraîtra huit mois après le drame. Nombre de fragments de son livre sont hantés par l'image de la femme aimée défigurée, et par l'impuissance du poète à inverser l'issue fatale : « Meidosem à la face calcinée ». Pour lutter contre l'horreur, il ne reste plus à Henri Michaux qu'à spiritualiser le corps souffrant, avant son passage vers le "Grand Opaque".
« Des ailes sans têtes, sans oiseaux, des ailes pures de tout corps volent vers un ciel solaire, pas encore resplendissant, mais qui lutte fort pour le resplendissement, trouant son chemin dans l'empyrée comme un obus de future félicité. / Silences. Envols. / Ce que ces Meidosems ont tant désiré, enfin ils y sont arrivés. Les voilà ».
C'est ici la page 63 (sur 68, au total) du tapuscrit, avec de nombreuses ratures et corrections à l'encre et au crayon, ensemble sur lequel a travaillé directement l'éditeur René Bertelé. Autres temps !
La dédicace de Michaux à son éditeur : "A René Bertelé qui a bien voulu ne pas considérer comme négligeables les frêles Meidosems quand ils étaient à peine à l'horizon et prêts à s'y reperdre. Au plus encourageant des amis. H. Michaux". L'auteur a signé deux fois sur la dernière page.

Henri Michaux, l'une des 13 lithographies de Meidosems,
tirées à même la pierre par Desjobert
18/02/2021 | Lien permanent
”Ecuador - Journal de voyage”, d'Henry Michaux, éd. Gallimard, 2 juillet 1929, 756 exemplaires, 200 pages
Le 27 décembre 1927, Michaux embarque sur le Boskoop, dans le port d'Amsterdam, à destination de Guayaquil (Équateur). Au regard de "l'anticalendrier de la mer", il va noter presque jour après jour les étapes de ce voyage pas comme les autres. Fourbu, il revient au port d'attache le 6 janvier 1929 et confie quelque temps après son tapuscrit à Gaston Gallimard.
Il a déjà écrit "Les rêves et la jambe" (plaquette), "Fables des origines" (éd. du Disque vert), a publié "Qui je fus" à la N.R.F. Voici l'un de ses poèmes de voyage, puisé dans la version originale d'Ecuador, pages 154-155 :
* * *
Samedi 3 novembre en pirogue souffrant et sans doute avec fièvre.
Prêtez-moi de la grandeur,
Prêtez-moi de la grandeur,
Prêtez-moi de la lenteur,
Prêtez-moi de la lenteur,
Prêtez-moi tout,
Et prêtez-vous à moi,
Et prêtez encore
Et tout de même ça ne suffira pas.
Le désespoir est doux,
Doux jusqu'au vomissement.
Et j'ai peur, peur.
Quand la moelle elle-même se met à trembler,
Oh ! j'ai peur, j'ai peur
Je n'y suis plus, je n'y suis presque plus.
Oh, mon ami,
Je m'accroche à ton souvenir.
A ta haute stature,
Je m'accroche mais je tombe,
Je me lâche.
Je n'étais donc pas tellement moi-même qu'on me l'avait dit.
Je vis à la renverse.
Encore un jour ? encore deux ?
Et Iquitos d'ici est encore à 12 jours.
Henry Michaux
20/02/2021 | Lien permanent