13/02/2016
Poésie roumaine III : Marta Petreu
Marta Petreu est née le 14 mars 1955, en Transylvanie, près de Cluj, où elle a fait ses études de philosophie. Elle a d'abord enseigné au lycée, puis à l'Université. Marta a dirigé la revue de littérature Apostrof :
Le septième jour
Il aime bien ce qu'il a créé avec une grande économie de verbes,
de gestes
comme un cardiaque qui compte ses battements de coeur
la fin est proche le désespoir subit la jouissance précoce
le coeur qui pète
quand la fête bat son plein le septième jour par exemple
vlan
oui vlan juste au milieu de l'amour
Quel soleil sublime - je m'exclame - quel monde nouveau
Seigneur
ton monde comme il est beau
Puisque son sexe peut encore tracer des calligraphies érotiques,
au hasard
il aime ses créatures : comme un cardiaque
il économise ses gestes
Oui. Le monde tombe de la genèse
tout droit dans le mécontentement de soi-même : oh quel bain tiède
on y patauge : ni chaud ni froid
les vices sont truqués et mesquins
minuscules, comme le démon d'Ivan
sans diamants ni sentiments comme la nuit
sans velours qu'on a tellement attendue
la nuit mûre de ma féminité ratée
Il aime ses créatures avec une grande économie de pensées de coeur
comme un cardiaque qui dort
près de sa dernière Sabine - celle qui a quitté d'elle-même les Sabins
(l'amour et l'insomnie m'effraient - disait-il -
il m'apporte le goût féminin
de la mort)
la nuit mûre de ma féminité usée
quel soleil merveilleux - quel splendide monde nouveau
Marta Petreu traduite par
Ed Pastenague
14:39 Publié dans Poèmes, Traducteurs | Lien permanent | Commentaires (0)
Poètes coréens : Hwang Tonggyu, Ko Un, Sin Kyongnim
On surnomme Hwang Tonggyu le « poète vagabond » ; il est né en 1938 à Séoul où il a enseigné. Membre du groupe ultra-moderniste dit « des quatre saisons », il développe une œuvre à la fois lyrique et ésotérique.
En culotte la main gantée
Je regarde en bas le parking noyé par la pluie nocturne
Je ne dors pas
J’attendrai Je permettrai
Je permettrai tout
Jusqu’à ce que ton mal de vivre
Me fasse de nouveau pleurer
Jusqu’à ce que je m’arrête
Silencieux comme la monture du triste cavalier
Sur la colline
Sur l’autre rive de ton village.
Hwang Tonggyu
Extrait du Journal d’Iowa (à une femme)
* * *
Ko Un fut moine zen jusqu’à l’âge de 26 ans. Son œuvre reste marquée par le lyrisme bouddhiste que manifeste sa prédilection pour la méditation sur la mort. Depuis son retour à la vie séculière, engagé politiquement dans l’opposition, il a composé plus de 30 recueils de poésie.
Canard sauvage
Canard sauvage
Canard sauvage
Où vas-tu
Je vais vers la rivière Chongchu
Pour quoi faire
Pour faire des petits
Combien de petits
Un Deux Trois Je ne sais pas
Si tu y vas un jour j’irai aussi
Flap flap flap
Ko Un
* * *
Sin Kyongnim est né en 1936 à Chungwon, étudiant à Séoul, son oeuvre est animée par une double préoccupation : la division de la Corée et le drame vécu par les paysans face à l'industrialisation et à la modernisation.
Ces deux yeux
(la chanson de la statue)
Deux bras mangés par le char ennemi
La langue coupée par les dents ennemies
Il ne me reste que ceci
Ces deux yeux
Qui me demande de les donner aussi ?
Personne ne pourrait me les arracher. Ces
Deux yeux
J'observerai les feuilles mortes La neige blanche
Qui tombent sur la tête de mon pauvre peuple et leur fin.
Je les observerai jusqu'au bout
Pour voir la fin des oppresseurs et des opprimés
Je n'ai que ceci Ces
Deux yeux
Sin Kyongnim
10:08 Publié dans Poèmes | Lien permanent | Commentaires (0)
12/02/2016
Alessandro Ceni
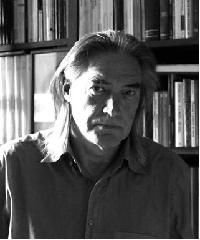
Le poème ci-dessous est extrait de la seconde partie du recueil Mattoni per l’altare del fuoco (Des briques pour l’autel du feu), qui en compte trois, chacune ayant fait l’objet d’une publication antérieure : Nel regno, 1993 ; La realtà prima, 1995 ; Ossa incise e dipinte, 1999 — rassemblant une oeuvre poétique qui s’étend d’août 1991 à juin 1998.
Alessandro Ceni est né à Florence en 1957. Poète, traducteur, peintre quand il n’écrit pas, il signe une poésie singulière, ardue, aux traits parfois obscurs et déroutants ; elle révèle des vers d’une grande densité, au puissant processus métaphorique, marqués d’un enracinement profond dans la langue toscane ; s’y décline un attachement viscéral au langage de la terre et du monde agraire où la nature prévaut en tous ses éléments, animal, minéral et végétal, doublé d’une dimension sous-jacente et omniprésente du sacré.
Valérie Brantôme
* * *
Alessandro Ceni,
poème XXII extrait de La realtà prima (La réalité première), deuxième partie du recueil Mattoni per l’Altare del fuoco (Des briques pour l’autel du feu), paru aux éditions Jaca Book, Milan, 2002. La traduction qui suit est inédite en français.
Traduction de Valérie Brantôme, 2011.
XXII
Dove libramente al vento
il seme del cipresso selvatico si sparge e il cielo sbanda
producendo neve
e un angelo si stacca e muore
s’impiglia a una bacca di rovo e
ficca il morto muso già rigido e nero
nel fogliame umido e verde della terra, la mia infanzia,
prima come portata da una barca, dal dorso di un pesce,
che rapido guadagni l’aperto del mare, poi
imitanto il passo del tordo e dell’airone, appare:
ed ecco, sul ramo del melo il vento
pone volti divorati dalle stelle
e nuovamente vi sostano fantasmi di uccelli,
che né cantano né guardano né hanno pietà del moi ricordo:
dalla finestra si scorgeva un siderale ghiacciaio
infisso nel punto in cui si scompariva la luce,
andava coi fratelli, tra gli immortali,
dietro lo spigolo della casa
da dove qualcuno ti chiamava
affacciato sul vuoto
tendendo una lampada spenta.
XXII
Là où librement au vent
se répand la graine du cyprès sauvage, là où le ciel
se disperse jusqu’à la neige
et où l’ange se détache et meurt,
reste accroché à une baie de roncier et
fourre son museau mort, déjà noir et raide
dans le feuillage humide et vert de la terre,
là apparaît mon enfance,
d’abord comme portée par une barque, par le dos d’un poisson
qui gagnerait très vite la haute mer, puis
imitant le passage de la grive et du héron :
et voici que sur la branche du pommier le vent
dépose des visages dévorés par les étoiles
et que s’y arrêtent, renouvelés, des fantasmes d’oiseaux,
qui ne chantent ni ne mirent, ni pitié n’éprouvent pour mes souvenirs :
depuis la fenêtre, on aperçoit un glacier sidéral
incrusté au point de disparition de la lumière,
il allait aux côtés de ses frères, parmi les immortels,
derrière l’angle de la maison
d’où quelqu’un t’appelait,
penché sur le vide,
brandissant une lampe éteinte.
13:40 Publié dans Poésie italienne | Lien permanent | Commentaires (0)

