09/08/2016
"C'est lui, l'artiste", par Estelle Folsheid
Un conte paru in Diérèse opus 43 :
C'est lui, l'artiste
Nous sommes dans la cuisine, à boire le premier café. Enfin, surtout lui. Son qahwa comme il dit pour faire Afrique. Il est en face de moi. Il s'assoit toujours à la même place, dos à la fenêtre, pour me laisser la vue : il sait comme j'aime la couleur du matin de l'autre côté de la vitre. Ce matin encore, la couleur du matin dans son dos le contourne en lumière. Ses mains autour du bol, comme chaque matin, j'essaie de percer leur secret.Je me dis, c'est miraculeux, cette passion pour deux paumes. Ou parfois, c'est idiot, cette passion pour deux paumes. Moi, sa peau sur la mienne, je ne pense qu'à ça. C'est drôle. Il ne me croit jamais quand je lui dis qu'il me plaît. Il dit "arrête". Il croit que je suis tombée amoureuse quand il jouait la pièce de Koltès. C'est vrai qu'il était fascinant dans ce rôle. Chaque soir, j'étais magnétisée. Lui voudrait que je l'aime pour lui-même. Comme s'il n'était pas lui quand il est sur scène. Il dit : "c'est trop facile de plaire quand on est acteur." Moi ça ne me dérangerait pas qu'il m'aime parce que je suis une bonne actrice. Mais il ne vient jamais me voir. Il dit qu'il m'aime pour moi, qu'il n'a pas besoin de me voir jouer pour m'aimer. Quand je joue, j'imagine qu'il est venu quand même, en secret, qu'il est dans le public, qu'il meurt d'envie de se lever en plein spectacle pour dire au monde entier : "c'est elle, c'est elle que j'aime."
Il me sert un autre qahwa pour que je l'accompagne. Il sait que je ne le boirai pas. Il passe sa matinée comme ça, dans la cuisine, à remplir son bol de café refroidi. Il attend. Quand je rentre le soir, il y a l'odeur du café partout dans l'appartement. J'aime bien cette odeur brûlée, un peu amère, comme si chez nous, c'était quelque part en Afrique. Il a voulu qu'on mette un téléphone dans la cuisine. Comme ça, il était plus près du café pour attendre.
Chaque soir quand je rentre, le téléphone a mon premier regard : a-t-il changé de place ? je me dis toujours que si le téléphone a sonné, il a dû changer de place. Même un tout petit peu, ce serait un signe ! Mais le téléphone reste toujours à sa place. Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, personne n'a pensé à lui. Alors, je sais qu'il ne voudra rien savoir de ma journée. Que si je commence à raconter, il explosera. "ne sois pas niaise. Tu sais bien que tu joues parce que tu es la fille de ton père !". Que si je m'approche, "je ne te mérite pas. Je ne te mérite pas...", il faudra que je trouve un biais pour qu'il m'étreigne, et qu'il oublie ma carrière et mon père... que je me fasse toute petite, "je ne te mérite pas...", pour qu'il me mérite. Alors, sous ses mains qui râpent, je retrouverai pourquoi je l'aime : parce que sous ses mains, je renais, je renais... Sa manière, si particulière, de déplacer son corps et le mien, comme dans la pièce de Koltès : son corps me tient dans ses fers.
Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Je n'ai jamais compris pourquoi il refusait tous les rôles qu'on lui proposait. Il disait : "on n'a qu'une vie. On ne peut pas faire de compromis. Plutôt crever que de se prostituer." Je ne l'ai jamais poussé. J'aimais qu'il soit acéré.
Maintenant quand nous sortons, il ne veut plus prendre le métro. Pour éviter les affiches. Ça le révolte, les comédiens qui vendent leur gueule à des marques de rasoir.
Il sent que je le regarde, il lève les yeux sur moi. Il me bouleverse. C'est lui, l'artiste ; pas moi. Personne n'a jamais voulu comprendre cela. Ma mère m'a dit : "Tu es Capricorne ; ton obsession, c'est pour ça..." Il me regarde si fort, j'ai envie de lui dire une nouvelle fois : "Comme tu es, je t'aime" mais il déteste ça. Si je dis ça, il croit que je n'ai plus foi en lui et que le téléphone ne sonnera plus jamais pour lui proposer le rôle de sa vie ; alors je ne le dis pas. Et dans la cuisine, on fait silence pour mieux entendre le téléphone qui ne sonne pas.
* * *
Un soir, je suis rentrée plus tôt que d'habitude du théâtre. Soudain une envie douloureuse de sa peau et de ses mains. Machinalement, j'ai quand même jeté un coup d'oeil sur le téléphone.
Il n'était plus sur la table. Il l'avait déplacé ! Alors, ça y est ? On l'avait appelé... J'avais envie de hurler et l'appartement vide gonflait encore ma joie et mon envie de lui : il était déjà là-bas, c'est sûr, à travailler son rôle. En riant, je prends sa place dans la cuisine pour l'attendre. Dos à la fenêtre. Je le ferai rire quand il rentrera... Je l'imiterai, sa drôle de voûte au-dessus de son bol de café.
Difficile de rester assise, avec ces envies de lui qui m'entaillent. Je me dis : aujourd'hui, il me méritera. Aujourd'hui, je n'aurai pas besoin de le supplier pour qu'il me prenne ! Je prépare du café et je remets le téléphone en place. Je prends son attitude et je tapote comme lui le bord de la table. Tam-tam, qahwa, je prends le rythme de son corps du matin dans la cuisine. Ça calme un peu ma hâte et je ris. L'odeur du café, le son du tam-tam... Je pense à toutes les fois où j'ai extirpé de sa chaise pour qu'il m'étreigne et m'emmène dans la musique à même le carrelage. Dans la cuisine bleu-piscine, sous ses mains qui râpent, alors j'ai l'impression d'être un poisson qu'on écaille, et des copeaux de ma peau, je me débarrassais comme une gamine pour renaître femme.
Au petit matin, il n'était pas encore rentré et j'ai trouvé qu'à la lumière du matin, les murs bleu-piscine étaient sordides. Je fais du café frais pour son retour, le corps tout engourdi d'être restée assise. L'odeur de café me fait sourire : elle va le faire venir. Comme lui, même haleine et même rythme, j'infiltre mon corps de café et je laisse le téléphone sonner : il sonne sans arrêt, sans doute mon metteur en scène, et se mêle au bruit chaotique de la cafetière. La langue limée par le marc de café, j'ai le sang qui noircit et des tremblements. Mon ventre rumine noir aussi, à cause du qahwa et tout ce que j'essaie de saisir s'écrase par terre. Je ne ramasse pas les débris, je l'attends. Et les murs bleu-piscine m'asphyxient, comme une odeur terreuse de café. Refroidi.
* * *
Un mois plus tard, j'étais dans le métro en train de rêver à mon rôle. A un moment, le métro est resté coincé à une station. J'ai regardé par la vitre : station Gaîté. Mais en regardant, j'eus l'étrange impression de croiser le fer d'un regard très familier. J'ai regardé à nouveau.
Sur les murs de la station, sur les murs dix fois placardée, une affiche de publicité, gros grains et couleurs sublimées. Et sur l'affiche, l'homme que j'aime, son beau visage en gros plan, ses yeux bouleversants, plantés en moi bouleversée, plantés dix fois, plantés en moi, et ce slogan : "faire mâle", à côté d'un rasoir.
Estelle Folsheid
10:09 Publié dans Contes | Lien permanent | Commentaires (0)
08/08/2016
Deux poèmes inédits de Pier Paolo Pasolini, in Diérèse n°48/49, été 2000
Ce numéro de Diérèse, encore disponible, avait été concocté en grande partie par le traducteur Laurent Chevalier qui depuis s'en est allé. On peut y lire des pages inédites de son Journal (1948-1949), en voici les pages 80, 81. Ils aident à mieux comprendre la démarche intérieure de l'auteur, ce passage à la vie adulte, terra incognita :
Interrotto nel momento più limpido
nel momento in cui il cuore se prepara
a darsi al mondo che gli è stato dato
- le passioni ossessioni, le fedi incubi,
i doveri dogmi, - vidi che il mondo
per me era irreale. Restai per qualche anno
dentro una sua ombra. Ma mi era dato,
e in me nacque il caos : sulla purezza
passava il peccato senza scalfirla,
sull'ignito il noto come un elemento
estraneo, sulla carne il pentimento
come parte di essa : tutto finiva
in me, deposito di un mare
anche a sé assente, in una notte estiva.
* *
La diversità che mi fece stupendo
e colorò di tinte disperate
una vita non mia, mi fa ancora
sordo ai comuni istinti, fuori dalla
funzione che rende gli uomini servi
e liberi. Morta anche la povera
speranza di rientrarvi, sono solo,
per essa, coscienza.
E poiché il mondo non è più necessario
a me, io non sono più necesario.
Pier Paolo Pasolini
Confondu au moment le mieux venu,
au moment où le coeur se prépare
à se consacrer au monde qui lui a été donné
- les passions jusqu'à l'obsession, la foi qui couve,
les devoirs et dogmes - je vis que le monde
était pour moi irréel. Je demeurai quelque temps
plongé dans son ombre. Mais il m'était donné
et en moi naquit le chaos : sur la pureté
le péché passait sans la blesser,
sur l'inconnu le connu comme un élément
étranger, sur la chair le repentir
comme partie d'elle : tout finissait
en moi, dépôt d'une mer
absente à elle-même, par une nuit d'été.
* *
La diversité qui me fit splendide et peignit
de couleurs désespérées
une vie qui n'est pas mienne, me rend encore
sourd aux instincts communs, hors la fonction
qui rend les hommes esclaves
ou libres. Est mort aussi le pauvre
espoir d'y entrer, je suis seul,
pour elle, en conscience.
Et puisque le monde ne m'est plus nécessaire,
je ne suis plus nécessaire.
Trad. Laurent Chevalier
15:20 Publié dans Poésie italienne | Lien permanent | Commentaires (0)
06/08/2016
Edouard Pignon vu par Hélène Parmelin
Hélène Parmelin - de son vrai nom Hélène Jurgenson (11/8/1915 - 05/2/98) - écrivait en janvier 1976, à propos de la période des Grands nus d'Edouard Pignon (parti de Paris, le couple retrouve l'atelier du Moulin, ndlr) :
"Au bout du train de nuit, du morne de l'arrivée dans les gares le matin, l'entrée au Moulin a toujours quelque chose d'irréel. La mer et les îles. Les mimosas en fleurs, des quatre saisons. Les chiens. Les chambres qu'on retrouve. Tout un climat superbe de rochers et de cactus, de nature et de distance, de solitude sans solitude. Et de ciel plus généreusement présent qu'ailleurs. Avec un énorme feu d'oliviers sous les coqs de céramique des cheminées. La chambre. Les deux nus rouges. Le nu jaune. Et la tête de l'Ouvrier que personne ne connait.
Dans l'après-midi je le trouve dans l'atelier, tendu et surexcité. Les deux grandes toiles voisinent sur deux chevalets. Il écoute de la musique en les regardant. Il dit qu'il lui semble qu'il y a quelque chose là-dedans. Quelque chose qui commence. Quelque chose de nouveau. Bien sûr, dit-il, elles ne sont pas faites. Mais "elles ont quelque chose". Il répète cette phrase pendant tout le reste de la journée. Le soir. Avant de s'endormir il en parle encore. Il dit qu'il lui semble que quelque chose va sortir de tout ça. Il parle beaucoup. A la façon des peintres. Le personnage de droite dans la bleue. Ou le parasol bleu de celle de gauche. Ce n'est pas fait. En tout cas il se montre dans le bouillonnement de quelque chose qui commence. On entend un peu la mer. Et en-dehors d'elle, qui est comme un grondement lointain de métro, un silence si grand et si prolongé qu'on a l'impression de tomber dans un trou. "Tu peux dire ce que tu veux (je ne dis rien), il y a quelque chose dans ces deux toiles. Quelque chose de nouveau est en train de naître.
... Une phrase de Picasso le frappe en 1972. Il lui montre des diapositives de nus. Picasso y porte une attention extrême et ne cessera à chacun de nos voyages vers lui - jusqu'au dernier - de réclamer des nus, des aquarelles, des photos. (Il est difficile de trimballer les grandes toiles de nus...) Au premier regard Picasso dit, avec une espèce de sourire : "Tiens, tu fais de l'anti-Matisse !" Et il ajoute aussitôt avec une mimique chagrine : "Et tu fais aussi de l'anti-Picasso." Le contraire d'une arabesque et le contraire d'une harmonie. Le contraire aussi d'une construction, et d'une description."
Hélène Parmelin
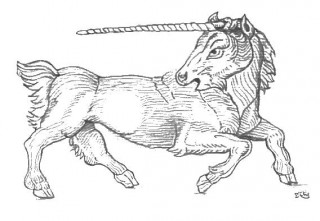
La Licorne, Daniel Martinez
A lire : Contre-courant, d'Edouard Pignon, Editions Stock, 1973
13:49 Publié dans Arts | Lien permanent | Commentaires (0)

