11/05/2019
Pour Diérèse 52/53 et 56 : Didier Periz, dernier éditeur du vivant de Thierry Metz, témoigne
Je me souviens de Thierry Metz
Je me souviens d’avoir lu ses mots la première fois dans une revue :
« Voici le plan : le Ciel
le Chantier
la Terre »
Je me souviens de m’être précipité chez le libraire pour y acheter Le Journal d’un manœuvre.
Je me souviens d’avoir acheté Le Journal d’un manœuvre par dizaines pour l’offrir, et tous les gens en restaient cois.
Je me souviens qu’avec Didier Schillinger nous lui avons écrit pour publier un livre de lui aux éditions Opales et qu’il nous a envoyé Dans les branches.
Je me souviens du salon du livre de Bordeaux en octobre 1995. Nous avons dîné ensemble dans un restaurant portugais et Jean-Luc Aribaud était avec nous.
Je me souviens d’une lecture dans un restaurant du quartier Saint-Pierre avec une dizaine d’auditeurs parmi lesquels Alain Juppé, alors premier ministre, et son épouse. Surréaliste.
Je me souviens qu’il a disparu.
Je me souviens qu’on l’a retrouvé à Orthez où il suivait une cure de désintoxication alcoolique.
Je me souviens qu’il n’avait plus rien, pas même un pantalon. Je me souviens qu’il fut très difficile de lui trouver des pantalons à sa taille.
Je me souviens qu’on allait le voir dans un établissement de post-cure du côté d’Arcachon.
Je me souviens qu’il occupait une chambre d’étudiant à Bordeaux et qu’il travaillait à la bibliothèque municipale.
Je me souviens que mon fils l’admirait parce qu’il cassait les noix entre ses doigts.
Je me souviens de ses Chroniques bordelaises qu’il écrivait pour Jour de lettres.
Je me souviens qu’il est allé parler de la poésie de Jacques Ellul dans une émission de radio animée par Guy Perraudeau.
Je me souviens de sa mobylette, une Moto-bécane bleue, sur laquelle il circulait à Bordeaux.
Je me souviens de l’anniversaire de ses 40 ans en juin 1996 fêté chez Alricq, une guinguette en bord de Garonne, avec D., S. et moi.
Je me souviens d’une crise d’éthylisme, un soir, entre le cours Victor Hugo et la rue Sauvageau. Je me souviens qu’il nous a raconté la scène de l’accident de son fils sur la nationale 113 et qu’on a pleuré.
Je me souviens qu’il a rencontré Paul Leuquet, bébé d’acier, artiste, avec qui il entreprit un dialogue interrompu.
Je me souviens qu’il voulait travailler au service des Jardins et qu’il ne voulait plus travailler à la bibliothèque.
Je me souviens qu’il buvait du pastis sans eau.
Je me souviens de son écriture avec ses drôles de jambages.
Je me souviens de sa grande gentillesse et de son innocence.
Je me souviens de sa soif de lectures et de son ambition d’écrire un roman sur Orphée.
Je me souviens de sa révolte et de son désespoir.
Je me souviens que sa conscience le portait aux franges de la conscience.
Je me souviens de sa joie d’enfant lorsqu’il a découvert la poésie verticale de Roberto Juarroz.
Je me souviens qu’il a rendu visite à Michel Ohl.
Je me souviens qu’il s’est rendu à l’hôpital Charles-Perreins en mobylette pour ne pas en finir avec lui-même.
Je me souviens de son premier séjour à l’hôpital psychiatrique de Cadillac.
Je me souviens du jour où il m’a apporté le manuscrit de L’Homme qui penche I.
Je me souviens de ma lecture de L’Homme qui penche I. Je ne me souviens pas d’avoir été plus bouleversé par un texte.
Je me souviens du bel et grand article de Sophie Avon dans Sud-Ouest pour annoncer sa présence à la librairie La Machine à lire.
Je me souviens qu’il n’y avait guère plus d’une quinzaine de personnes le soir venu à la Machine à lire.
Je me souviens d’avoir, ce soir-là, remis un exemplaire de L’Homme qui penche I à chacune des personnes présentes.
Je me souviens que c’était l’hiver et que Thierry Metz n’était pas en grande forme.
Je me souviens de son second séjour à Cadillac.
Je me souviens du jour où il m’a apporté L’Homme qui penche II à sa sortie de Cadillac II. Je crois me souvenir qu’on en a plaisanté, qu’on a plaisanté de ce drôle de séjour d’inspiration.
Je me souviens d’enthousiasme et d’apathie. Je me souviens peut-être d’une sorte de résignation.
Je me souviens qu’il a rendu visite à ses parents, là-bas à Soustons. Je me souviens qu’il m’a dit s’être promené sur la plage.
Je me souviens que lorsque son père a reçu sa lettre, Thierry était mort.
Je me souviens de lui avoir téléphoné et qu’il était mort.
Je me souviens de son enterrement à Soustons. Je me souviens d’y être allé avec Daniel de Marco. Je me souviens que là non plus il n’y avait pas grand monde. Je me souviens d’y avoir rencontré sa femme Françoise et ses deux fils. Je me souviens qu’on est allé boire un verre dans un bar du centre ville. Je me souviens que c’était triste et insignifiant. Je me souviens que mourir est insignifiant.
Je me souviens qu’après, des tas de gens se sont intéressés à Thierry Metz. Je me souviens qu’il y a eu au moins deux adaptations théâtrales de L’Homme qui penche dont une fut produite à Cadillac. Je me souviens que L’Homme qui penche a été traduit et publié en italien. Je me souviens qu’en italien, ça s’écrit « L’Uomo che pende ».
Je me souviens que Jean-Albert Bourgade a réalisé de magnifiques illustrations de L’Homme qui penche et que nous n’avons pas pu mener à bien son édition.
Je me souviens d’une soirée d’hommage et de lecture au bar Le Castan où des textes de Thierry et ceux des poètes qu’il aimait, Rilke, Apollinaire, Celan, Juarroz, Juliet… ont été lus par Martine Amanieu, Laure Duthilleul, Marc Feld et Paul Leuquet.
Je me souviens d’avoir édité Terre qui est sûrement l’un des plus beaux livres de poésie que je connaisse.
Je me souviens d’avoir édité Tout ce pourquoi est de sel, quintessence de la poésie de Thierry Metz.
Je me souviens de la dernière lettre que Thierry Metz m’a écrite :
« Bonjour Didier,
C’est le retour à la case départ – la case vide, celle qui me manque.
Ne m’en veux pas d’être aussi contrariant. Ça casse toujours au même endroit. Mais on m’a dit que c’était réparable.
Je pense à toi.
Je t’embrasse.
Thierry (lui et l’autre) »
Didier Periz, le 24 janvier 2011
Éditeur, Opales, Pleine Page, Bordeaux
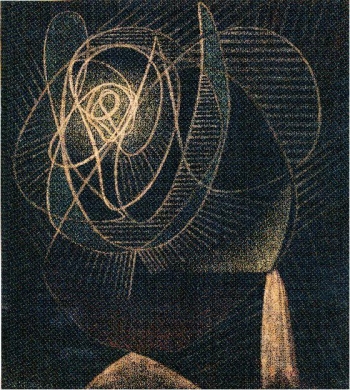
Hans Hartung (1904-1989) Huile et pastel sur papier goudronné
monté sur panneau (95 x 85 cm). 1945, Collection privée
07:27 Publié dans Diérèse | Lien permanent | Commentaires (0)
Diérèse 52/53 et 56 : Sophie Avon présente Thierry Metz
Thierry Metz, enfant radieux et homme des gouffres
Il avait les yeux clairs et des mains noueuses, larges, sculptées dans la caillasse qu'il semblait vouloir creuser pour l'éternité.
Les mots étaient sa pierre et sa terre, ce sur quoi il ne cessait de planter. A commencer par lui même qu'il lui fallait planter et planter encore pour tenir bon. Mais l'homme qui penche ne tient pas droit et le premier vent le ploie. Thierry Metz ployait, s'agrippant aux mots qui dormaient en lui et qu'il réveillait doucement, tirant d'eux une musique à fendre l'âme. C'était des mots en forme de pétales et de galets, des mots simples et courts, des mots nets et précis qui racontaient le fil du temps, détaillaient les jours de labeur ou de solitude. Avec ces mots-là, il traçait le jardin où chaque homme voudrait naître et mourir.
Ses mots ne pesaient guère ni ne peinaient. Ils ne consolaient sans doute pas non plus, pas assez - à commencer par celui qui les écrivait -, mais ils apaisaient l'esprit et remuaient étrangement. Ils ne pèsent pas davantage aujourd'hui où reprenant les livres de Thierry Metz, je tourne ces pages larmes aux yeux - et derechef, ils me remuent.
A la vérité, ses mots ne sont ni douloureux ni funèbres mais d'une lumière si éclatante au contraire, qu'ils empêchent de voir ce qu'ils dérobent. Ils sont si lumineux qu'ils éblouissent avant d'éclairer, et qu'éclairant ensuite, ils exposent un sens déjà enfui. C'est qu'ils se donnent la peine de tourner autour de ce trou noir dont le poète, infatigablement, reprend le cercle pour que la vérité du monde, éventuellement, consente à apparaître. Thierry Metz n'a fait que cela avec une patience de sage et une fragilité d'écorché : il a approché au plus près du réel sachant qu'il ne l'atteindrait jamais - ou si fugacement que le temps de l'effleurer, il serait déjà évanoui -, mais retournant les pierres, il a exhumé le ciel.
Poète qui bâtit et manœuvre qui creuse, déblaie, casse, refait, empile, cimente. On croit que c'est un travail physique, simple, or les mains n'y suffisent pas, ni la solidité du corps. Ce qu'il faut, c'est y plonger et accepter de n'en rien saisir.
Thierry Metz voulait-il "être graine pour revenir feuillage le soir", comme il l'écrit dans "Le Journal d'un manœuvre" ? Ou cherchait-il à jamais ce qui "s'est retiré, qu'on ne trouvera qu'après s'être soi-même retiré", comme il l'écrit dans "L'Homme qui penche" ?
"Ce que je vois n'est jamais complet, écrivait-il encore, silence et mots sont nos bûchers". Comment vivre quand on brûle d'écrire et de se taire, que les mots sont vains et que pourtant, ils sont là, au plus profond de soi, faits pour être cueillis, inaccomplis sans doute, incomplets et orphelins - mais néanmoins vibrants d'amour, d'humanité et de force ?
Comment fait-on quand on est un poète à la fois ailé et entravé ? Un esprit libellule dans un chagrin de plomb ? Une âme céleste enfermée sous la terre ? Un enfant radieux et un homme des gouffres ?
Sophie Avon
Sophie Avon, née en 1959 à Oran en Algérie, est une écrivain et critique de cinéma. Elle a fait ses études à Bordeaux et à Paris (au cours Florent), vit une année à Amsterdam, puis entreprend la traversée de l'Atlantique à la voile qui la mène jusqu'au Brésil. Son premier roman, Le Silence de Gabrielle, paraît en 1988. Onze ouvrages suivent, publiés chez Arléa, Gallimard, Denoël et au Mercure de France (en 2018, La petite famille).
07:18 Publié dans Diérèse | Lien permanent | Commentaires (0)
08/05/2019
"Hazel", de Bruno Sourdin, éd. Les Deux-Siciles
 Bruno Sourdin, Hazel, avec 4 collages de l’auteur, juillet 2005, éditions Les Deux-Siciles, c/o Daniel Martinez, 8 avenue Hoche, 77330 Ozoir-la-Ferrière, prix : 10 €, hors frais de port.
Bruno Sourdin, Hazel, avec 4 collages de l’auteur, juillet 2005, éditions Les Deux-Siciles, c/o Daniel Martinez, 8 avenue Hoche, 77330 Ozoir-la-Ferrière, prix : 10 €, hors frais de port.
Si l’Inde demeure une énigme pour nous, Occidentaux, alors on peut dire du recueil de poèmes de notre confrère Bruno Sourdin, intitulé Hazel, qu’il nous en donne parfaitement la mesure. Avec l’auteur, on s’aventure dans le labyrinthe de Madras, Pondichéry ou Bombay en compagnie de personnages mystérieux ou à la rencontre de silhouettes entrevues à contre-jour au bord d’un fleuve, ou, plus souvent, dans l’épaisseur de la nuit.
Mais Bruno Sourdin n’a pas écrit un road-movie, même s’il nous rappelle, au passage, tout ce qui le rattache à la Beat generation, à ses auteurs et à ses artistes (n’a-t-il pas consacré un livre à Claude Pélieu, créateur de collages ?)."Pèlerins errants et compagnons de route, et tous mes frères de la tribu des soleils". C’est ainsi qu’il nous les désigne au cœur de son recueil.
Si le livre de Bruno Sourdin nous interpelle, c’est qu’il invite à sonder le mystère du monde sensible. Que l’on soit à Madras, à Brocéliande ou dans la gare de Rennes. C’est, aussi, parce qu’il prend ses distances, à la manière des poètes de la Beat, avec toutes les turpitudes de notre époque. "Aujourd’hui, tout le monde se tait / Les jours radotent / La télé beugle".
Ainsi peut-on s’approcher de l’Inde avec lui, comme le fit en d’autres temps Herman Hesse, cité en exergue du recueil. Dans son livre Siddharta (1992), inspiré par l’Inde, le célèbre écrivain germano-suisse jetait un pont entre les cultures et cherchait un point de convergence pour les hommes. Bruno Sourdin révèle qu’il est aussi, dans la soumission au temps qui passe, à la recherche d’un ailleurs possible."Garde ta mélancolie à jamais / Laisse le bon temps rouler". Il termine même son recueil par une forme de haïku, au ton réjouissant. "Ah, la nuit sans sommeil / avec mon sac à dos, quel bonheur / Sur la route de Pondichéry".
Pierre Tanguy
20:41 Publié dans Les Deux-Siciles | Lien permanent | Commentaires (0)

